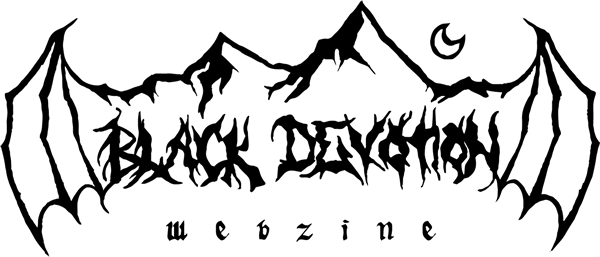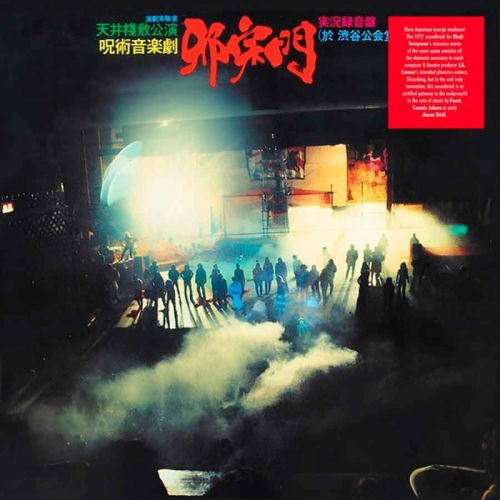
Année : 1972
Label : Victor
Pays : Japon
Durée : 52:13
Remarques : Album collaboratif avec Tenjo Sajiki (天井桟敷), troupe théâtrale formée par le poète Shuji Terayama, qui apporte une épaisseur gargantuesque à cet album
Baby Metal, WTF quoi, voyages balisés chiants attrape-touristes, sous-culture du vide, bouffe industrielle dégueulasse de konbini, j'apprends la "culture" japonaise avec Louis-San, Tev et Ichiban.
Vos gueules.
Vraiment, j'en peux plus de vous. L'indigent le dispute au produit marketé pour otakus fainéants.
Plus de quinze ans que j'explore régulièrement la musique nippone et si je devais n'en garder qu'un, je pense que J.A. Seazer serait en très bonne position ; sa période années 1970 m'a pas mal accompagné lors d'un séjour de quelques mois dans l'Empire du Soleil Levant. Derrière cet obscur patronyme se cache Terahara Takaaki, personnalité contestataire reconnue depuis les événements de 1967, leur "mai 1968" ouvrant sur une intense décennie de créations culturelles et de tensions sociales dans un Japon en pleine modernisation.
Tension et création sont justement les deux mots qui guident ce Jashumon absolument inclassable. Car comment décrire convenablement une œuvre qui sort du cadre conventionnel de la musique ? Presque modale par moments, c'est pourtant par un Kyojo Bushi à mi-chemin entre le chamanisme hippie et les incantations shintô que l'on commence. Comment comprendre ? Au niveau des sonorités, nous sommes plutôt dans un croisement entre l’acid folk, le rock psychédélique et des borborygmes éructés qui suintent la folie. Suivent, dans la plus parfaite anarchie, récital quasi-religieux, spoken-word dément, passages bruitistes, claviers fantomatiques dans une ambiance démesurée, mi-spectrale, mi-cinématographique. Très cinématographique. Comme un film japonais de cette époque, là où la couleur hallucinée d’un Belladonna ou d’un Lady Scorpion dévore la classe des perles “nouvelle vague” nippone, d’un noir et blanc, aussi classieux qu'érotique.
Comment le définir : Rock psychédélique ? Bande-originale de film/théâtre ? Acid folk ? Néo-enka ? Spoken-word ? Jazz ? Objet Musical Foutrement Non-Identifié ? Une avalanche de mots-clefs ne saurait rendre hommage à ce grand-oeuvre.
Jashumon est TRÈS TRÈS LOIN d’être accessible. Mais aussi tordu qu’il soit, aussi glaçant qu’il peut se révéler dans sa première partie, il est prenant, accoutumant. Des chants féminins, solitaires ou en chorale, comme une kermesse nostalgique, font face à des riffs de rock psychédélique quasiment garage. Le rythme s’emballe, tu t’emballes, tu deviens carrément dingue, et tu remets ce fantastique Tokyo Junreika qui est presque une communion.
Impossible d’en parler vraiment sans se lancer dans une thèse, mais vous l’aurez compris, c’est un pur chef-d’œuvre. Dans la catégorie du “Sombre et expérimental”, il remporte la palme. Mais au-delà.